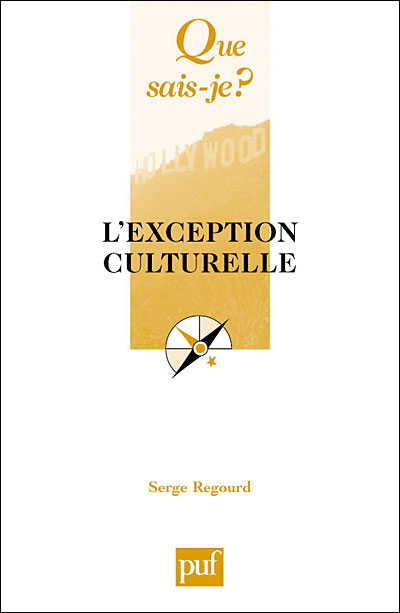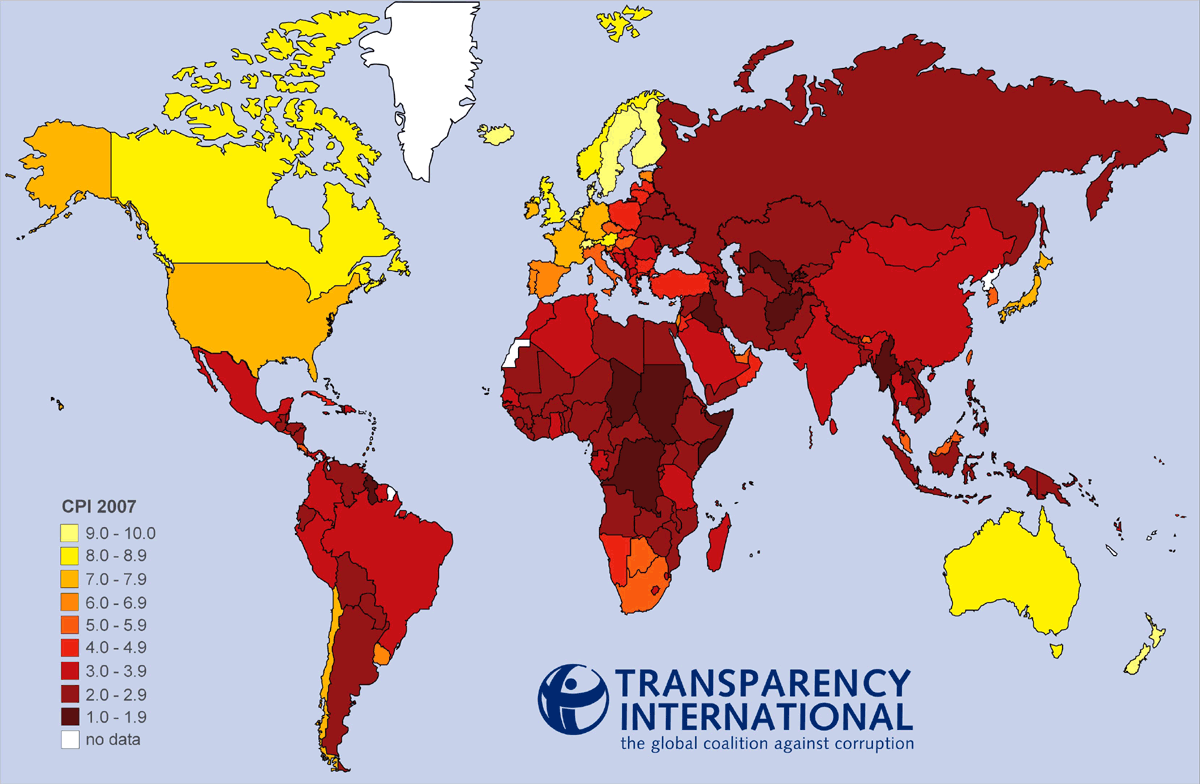d'après l'ouvrage de Serge Regourd
Nous sommes en 2010 et presque tous les secteurs de production économique des 153 états présents au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce ont cédé aux préceptes libre-échangiste et anti-protectionniste libéraux. Tous ? Non ! Car un continent peuplé d’irréductibles défenseurs de la diversité culturelle résiste encore et toujours à l’envahisseur américain.
Ainsi pourrait débuter le récit de l’épopée d’une notion devenue symbole du refus de l’uniformisation culturelle : l’exception culturelle.
Ainsi pourrait débuter le récit de l’épopée d’une notion devenue symbole du refus de l’uniformisation culturelle : l’exception culturelle.
Bien qu’apparue tardivement dans le débat public, en 1993, cette idée selon laquelle l’audiovisuel, et à travers lui la culture, « n’est pas une marchandise comme les autres » est en réalité bien antérieure à l’Uruguay Round qui la consacre.
S’attachant en premier lieu à retracer la genèse, les enjeux et les modalités de sauvegarde de l’exception culturelle, l’ouvrage homonyme de Serge Regourd nous éclaire ensuite sur la remise en cause de cette dernière et le parcours chaotique ainsi que la victoire en demi-teinte qui a assuré un sursis au secteur audiovisuel en terme de libéralisation.
Si l’exception culturelle en tant qu’argument contre la libéralisation totale de l’économie n’apparait qu’à la fin du XXe siècle, elle trouve ainsi ses fondements bien avant et, loin de n’être réservée qu’aux secteurs audiovisuel et cinématographique, elle peut s’appliquer à toutes les industries culturelles.
Intimement liée au développement de l’industrie du cinéma français, cette notion va émerger dès les années 30 auprès des professionnels de ce secteur qui vont, à cette époque, se constituer en syndicats afin de défendre leurs intérêts. Déjà reconnues comme « source de jouissance intellectuelle » (jurisprudence Doyen, 1905), les œuvres cinématographiques bénéficient, dès 1928, d’un contingentement appliqué aux productions étrangères dans le but de protéger les « traditions nationales » (dixit Edouard Herriot).
Ce protectionnisme culturel est également le fruit d’un régime, la IIIe République, où « le pacte républicain » -qui promet l’Egalité- motive un volontarisme de la puissance publique (et donc une conception spécifique des rapports entre l’Etat et le marché) et un refus de la domination américaine selon ce que De Gaulle qualifiera plus tard « une certaine idée de la France », une idée qui illustre sa grandeur et refuse l’abandon de son patrimoine culturel aux lois du marché, une idée qui gardera toute sa place au sein des IVe et Ve République.
Va ainsi s’ajouter à ce protectionnisme de quotas un protectionnisme de subventions. Commandé par des intérêts économique et culturel, le régime de Vichy va ainsi, en 1940, mettre sur pied un organe chargé de la régulation et du financement des œuvres cinématographiques, le COIC, ancêtre de l’actuel CNC né à la Libération (1946). Dès sa naissance, cet organe est ainsi chargé d’assurer un soutient à la production d’œuvres françaises en même temps que de favoriser leur diffusion par rapport aux œuvres étrangères, et notamment américaines.
Cette même année, l’accord Blum-Byrnes, contraignant la France à l’importation et la diffusion de films américains, ne manquera pas de déchaîner les passions dans le monde du cinéma.
Le traité de Rome de 1957, qui institue la Communauté Européenne, marque à sa façon l’existence effective de ce qu’on appellera bien plus tard l’exception culturelle. En effet, si auparavant chaque état menait sa politique selon son bon vouloir, les six pays qui s’engagent en 1957 le font sur la base de fondements strictement libéraux.
De fait, on aurait du assister par la suite à une suppression des subventions aux productions nationales par les états membres, voire à une suppression des quotas, d’autant plus après que la Cour Européenne de Justice a, en 1974, consacré l’appartenance des œuvres audiovisuelles à la catégorie des services (jurisprudence Sacchi), exclus à l’époque des accords du GATT mais déjà concernés par la dérégulation communautaire.
Plus étonnant encore, ce protectionnisme appliqué à l’audiovisuel sur le vieux continent sera accentué par l’Acte Unique de 1986, qui fonde le marché commun, puis par le traité de Maastricht en 92.
De multiples mesures protectionnistes verront donc le jour en France et en Europe tout au long de la seconde moitié du XXe siècle et plus encore dans les années 80 et 90.
En France, la libéralisation des ondes hertziennes et radiophoniques et la poursuite du soutien au cinéma aboutira ainsi à la mise en place, en 1992, de taxes sur les distributeurs de contenus (chaînes hertziennes, tickets de cinéma), de quotas de diffusion télévisée d’œuvres françaises ou européennes (120h/an en prime time), de quotas de radiodiffusions de chansons françaises (1994) ainsi que d’aides au financement via des fonds tels que l’IFCIC ou la SOFICA.
Au niveau Européen, 1988 sera marqué par la création du fond de financement EURIMAGES avant que le Conseil de l’Europe mette en œuvre, dès 1990 et jusqu’en 2006, une politique de stimulation de l’industrie audiovisuelle européenne à travers trois plans quinquennaux (Media I puis Media II et enfin Media PLUS). Par ailleurs, il faut noter que le traité d’Amsterdam, signé en 1997, consacre et légitime l’existence et le double financement (publicitaire et par l’imposition) des chaînes publiques.
Comme nous pouvons le constater, il semble bien que la Communauté Européenne, malgré les préceptes libéraux sur lesquels elle se fonde, accorde une place toute particulière aux productions culturelles et plus particulièrement audiovisuelles.
La menace libérale à l’origine de la levée de bouclier des défenseurs de l’exception culturelle n’est donc pas liée à la construction européenne…
La menace libérale à l’origine de la levée de bouclier des défenseurs de l’exception culturelle n’est donc pas liée à la construction européenne…
______________
Et pour cause, elle est liée à une construction qui, certes, partage sa logique libérale, mais se veut autrement plus large, et donc plus « globalisante ».
Cette construction, plus vaste et qui réveille la peur de l’uniformisation culturelle, c’est celle du commerce mondiale.
Cette construction, plus vaste et qui réveille la peur de l’uniformisation culturelle, c’est celle du commerce mondiale.
Elle débute en 1947, à Genève, avec la signature du GATT. Cet accord est alors le premier d’une série de cycles de négociation (également appelés « Rounds ») destinés à libéraliser le commerce international. Dans une première phase ces cycles se concentreront sur la libéralisation des marchandises avec de s’attaquer, en 1986, à celle des services, qui constituent la seconde phase de cette série d’accords qui débouchera, en 1994, sur la création de l’OMC qui, si elle offre un cadre institutionnel commun qui peut contrôler et sanctionner, n’est pas une finalité en elle-même mais poursuit les négociations avec toujours pour but une libéralisation et une transparence croissante.
Cette seconde phase débute donc en 1986 à Punto del Este avec l’Uruguay Round et se propose de déréguler, entre autres secteurs tertiaires, celui de l’audiovisuel.
Malgré l’interventionnisme européen et français qui prévalait déjà dans ce domaine, les contestations vont tarder à se faire entendre. Ainsi, c’est seulement en 1993 qu’elles vont éclater en France avec un retentissement médiatique important. Les professionnels du cinéma et de la télévision se joignent alors aux promoteurs de l’idée d’exception culturelle, parmi lesquels François Mitterrand et Jacques Delors, pour monter au créneau et faire passer leur message.
Et la tâche n’est pas aisée pour ces partisans de la diversité puisque c’est la Commission Européenne qui est chargée de négocier au nom de l’union avec à sa tête le conservateur britannique Sir Leon Brittan, proche de Thatcher et plus acquis aux attentes transatlantiques qu’aux soucis culturels français.
La France se retrouve ainsi isolée. En effet, bien que les autres pays européens ne soient pas nécessairement pour une libéralisation totale, ces derniers (moins protectionnistes) subissaient déjà avec force l’hégémonie de la production audiovisuelle américaine et, par là même, avaient moins d’enjeux réels et symboliques à sauvegarder. Le bras de fer s’engage alors entre la France et les Etats-Unis, chacun des partis menaçant de se retirer des négociations.
Mais l’argument de l’exception culturelle va trouver un nouveau retentissement grâce au Parlement Européen. Dès lors, impossible pour le commissaire européen en charge des négociations d’aller contre la volonté de l’organe représentatif.
De plus, l’exemple du Canada qui, dans le cadre de l’ALENA, a obtenu en 1988 l’exclusion de l’audiovisuel des services dérégulés, encourage l’opposition.
Finalement, le problème va surtout être le fait d’un déficit juridico-sémantique portant sur les termes de l’accord lui-même : spécificité culturelle, exception, exclusion comme dans le cas du Canada ; personne n’arrive à se mettre d’accord, si bien que les accords de Marrakech signés en 1994 ne comporteront finalement aucun engagement concernant l’audiovisuel.
A l’issue de cet accord, on peut certes dire que la notion d’exception culturelle a triomphé, mais pour combien de temps ?
1 an. Ni plus, ni moins. Et pour cause, dès 1995, une nouvelle offensive néolibérale, venue tout droit de l’OCDE qui regroupe les 29 pays les plus riches de la planète, va dans le plus grand secret discuter d’un nouveau texte. L’Organisation de Coopération et de Développement Economique va ainsi, deux ans durant, en échappant à tout contrôle, échafauder un projet d’accord nommé AMI pour Accord Multilatéral sur l’Investissement qui, loin de se limiter au thème de la libéralisation de l’audiovisuel, remet en cause le pouvoir souverain des états dans le contrôle des investissements étrangers en imposant, dans tout les domaines, la clause du traitement national sans individualisation possible. En plus de remettre en cause le principe d’exception culturelle, ce texte allait jusqu’à éradiquer toute forme de volontarisme de la part de l’Etat, dans des domaines aussi divers et variés que la santé, l’éducation, les transports publics ou encore la protection sociale.
Ainsi, si les professionnels de l’audiovisuel et du cinéma furent les premiers à dénoncer ce projet, aux côtés d’Organisations Non Gouvernementales et toujours selon le principe de l’exception culturelle, leur position parue bien vite bancale quand fut découverte la portée beaucoup plus globale et d’autant plus inquiétante de l’accord en gestation. Le retrait de la France des négociations en octobre 1998 entraîna finalement le dessaisissement de l’OCDE et l’abandon du projet AMI.
Cependant, la vaste contestation internationale provoquée par ce projet eu d’autres retentissements puisque l’année suivante, le mouvement anti-mondialisation allait signer l’échec du Millenium Round qui se tenait à Seattle.
A la veille même de ce sommet, l’Union Européenne déclarait maintenir la position qu’elle tenait de l’Uruguay Round tout en substituant le terme de diversité culturelle à celui d’exception. Ce changement sémantique visait alors à fédérer davantage les européens et les pays tiers à une position perçue, à raison, comme trop française au point de paraître égoïste. Si le consensus européens en est né, cette terminologie a cependant remis en cause la légitimité du protectionnisme puisque la diversité implique davantage l’égalité de traitement des offreurs que la préférence accordée aux nationaux. Cette ambiguïté a, de fait, laissé la porte ouverte à toutes les issues…
Au terme de cet ouvrage, qui revient dans ses dernières pages sur des sujets épisodiques ou peu développés, on comprend donc que si la notion d’exception culturelle forgée en butte à la libéralisation des industries audiovisuelle et cinématographique a pu les protéger un certain temps, elle ne saurait être une réponse définitive face aux assauts du libéralisme. Déjà fortement remise en cause, celle-ci manque d’ailleurs de pertinence puisque, s’appliquant presque exclusivement aux créations audiovisuelles dans l’utilisation qui en est faite, elle oublie de se préciser ou de se refondre dans des optiques plus vastes qui prendraient en compte la culture de manière plus large et appropriée. Et si cette exception est réellement devenue diversité culturelle, les implications de cette nouvelle conception risquent d’être bien plus considérables et étendues que la seule défense d’intérêts nationaux qu’elle risque d’ailleurs de mettre en péril…